Le transfert, le transfert, est-ce que j’ai une gueule de transfert ?

Nous connaissons tous la fameuse réplique d’Arletty face à Louis Jouvet, dans Hôtel du Nord : le « transfert », à l’ordinaire, c’est un peu comme l’atmosphère dont il se plaint, une atmosphère dont on ne peut se débarrasser, où qu’on aille !
Dans n’importe quelle relation, c’est le même air qu’on respire, tôt ou tard, la même odeur de renfermé : celle d’un vieux schéma qui se répète, en boucle, et qui étouffe ! À croire qu’on y est condamné…
Pourquoi toujours plus ou moins le même profil d’hommes ou de femmes, avec lesquels, bien entendu, ça « tourne mal », se demande telle personne ? Pourquoi toujours plus ou moins le même dilemme, en amitié ou au travail, se demande telle autre ? Qu’en déduire ? Le cerveau humain serait-il un gros maso ?
Non, bien sûr : il est simplement fait pour apprendre. C’est un avantage qui a été tout particulièrement sélectionné par notre espèce pour sa survie. Et pour cela, le cerveau compare chaque situation nouvelle à ce qu’il connaît, ce qu’il a en mémoire. Il essaie d’anticiper. Il projette donc sur les protagonistes de son actualité les figures de son passé. Mais il fait plus encore : pour solutionner le problème qui le préoccupe, le bougre cherche à réunir les conditions… de sa réédition !
Le transfert à l’état sauvage
Nous avons tous des blessures, des problématiques à résoudre, voire des traumas. Notre cerveau cherche à les dépasser, en nous faisant vivre de nouvelles situations ayant à voir avec cette part douloureuse de notre histoire.
Et pour cela, l’Inconscient fait une sorte de casting : avec un flair inimitable, il est systématiquement attiré par tous les candidats à même de rejouer la scène qui le hante, et chasse tous ceux qui n’ont rien à voir ni à faire avec. Au fond, c’est l’espoir d’un dénouement heureux qu’il poursuit, plus que tout. Voilà pourquoi on se sent souvent le jouet d’un scénario qu’on connaît bien, et qu’on n’a pourtant aucune envie, a priori, de revivre.
Manque de bol, les personnes ou les situations qui nous en éloigneraient trop, aussi « saines » soient-elles, n’intéressent pas l’Inconscient : elles sont traitées comme du « bruit » car elles font trop silence en lui, n’y produisent aucun écho de rien.
Des transferts « sauvages », nous en faisons tous les jours sur tout le monde, dans toutes nos relations. Nous transférons sur autrui nos représentations et conflits internes. Et « autrui »… nous le rend bien. Si bien que toute relation se charge fantasmatiquement, et parfois jusqu’à la confusion, à ne plus savoir à qui appartient quoi.
Pas toujours facile de reprendre ses billes, une fois embourbé dans les schémas de répétition, jamais aussi intensément à l’œuvre que dans les relations les plus investies.
Avec son psychanalyste aussi, d’une manière ou d’une autre, on le répète, ce fichu schéma qui sent la poussière ! Mais pas tout à fait comme partout ailleurs… Et c’est justement ce « pas tout à fait comme partout ailleurs »… qui changera peut-être tout…
Le transfert en psychanalyse
Ce qu’on appelle « transfert » est tout ce qu’on ressent spontanément pour, contre, en rapport avec l’analyste et/ou face à ce qu’il représente pour soi.
Au-delà de l’amitié analytique issue de la rencontre réelle, le transfert est l’ensemble des affects et des fantasmes, mais aussi des grandes figures du passé et des complexes non résolus qui vont être remobilisés sur la scène analytique, se répéter au cœur de la relation, sur la personne et la fonction de l’analyste, en grande partie à son propre insu.
Et comme l’analyste en tant que « petit autre », c’est-à-dire en tant que « personne comme une autre », est priée de se tenir en coulisses, il prendra nécessairement, sur la scène analytique, les dimensions du grand Autre, donnant à l’analysant l’occasion de revisiter avec une puissance inédite ses rapports à l’altérité, et tout ce qui peut s’y jouer ou s’y rejouer pour lui.

Côté analyste, c’est la part, dans le transfert, qui le concerne. Car tout aussi en retrait soit-il, le psy n’en est pas moins aussi un « petit autre », touché et co-acteur : son inconscient est bel et bien là, présent, et réagit.
Au-delà de l’amitié analytique issue de la rencontre réelle, son transfert est donc aussi l’ensemble de ce qu’il ressent, mais, pour simplifier, essentiellement en réponse au transfert qu’il reçoit : c’est en vertu de cette spécificité que la psychanalyse classique parle de « contre-transfert ».
Ainsi, transfert et contre-transfert mettent en mouvement la relation analytique, et c’est pourquoi celle-ci ressemble, à bien des égards, à un subtil pas de deux !
Un exemple concret
Plutôt que de me lancer plus avant dans un exposé théorique et désincarné de ce qu’est le transfert en psychanalyse, quoi de mieux que de plonger directement dans le feu de la pratique par le récit d’une séance clef ?
À travers un exemple concret, voyons comment le travail de l’analyste sur son propre transfert peut s’avérer un outil précieux, transformant ce qui aurait pu se traduire par un passage à l’acte (un acte impulsif, un geste trop familier ou une parole inappropriée) en acte analytique.
Cette illustration permettra du même coup d’introduire ce que la tradition nomme « complexe d’Œdipe » et de comprendre pourquoi celui-ci est aussi central en psychanalyse, dans sa théorie comme dans sa pratique.
Avertissement éthique : comme il s’agit du récit non fictionnalisé d’un moment clef de la psychanalyse d’une personne reçue il y a quelques années, j’ai pris soin de lui demander son accord avant publication. À la toute fin de cet article, celle-ci livre son propre regard et vécu, avec la distance qui est la sienne aujourd’hui, en réaction à la lecture de ce récit. Elle a choisi d’y apparaître sous le prénom d’Allegra, en hommage à la petite fille d’un rêve sur lequel nous avions travaillé en séance… Une petite fille qu’il s’agissait, pour elle, de sauver de la noyade… et qui, sans doute, n’était autre… qu’elle-même ! Que dire de plus, si ce n’est que ce prénom italien signifie « défense de l’humanité » ?
Sous la Sœur-mère, la Mère-sœur.
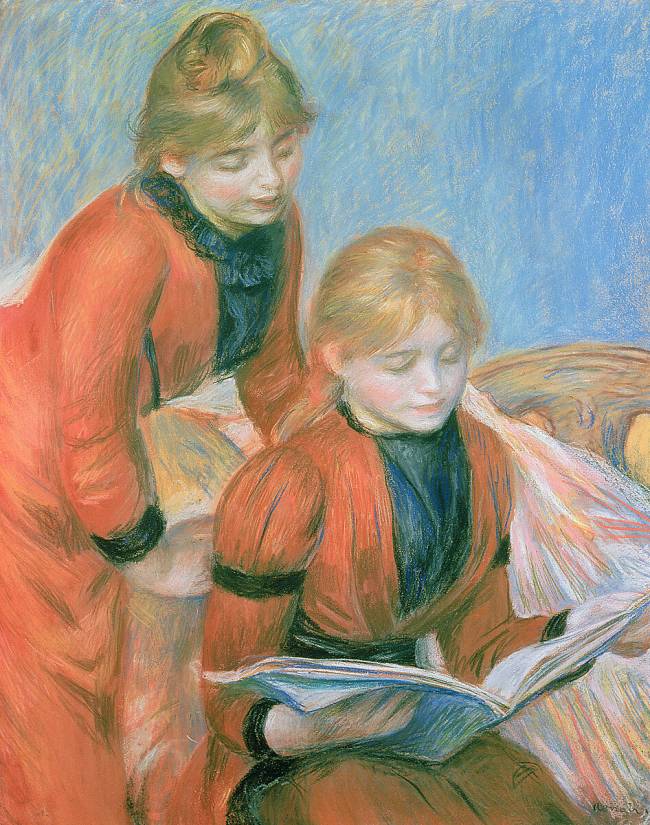
Allegra commence, comme à son habitude, par se féliciter de sa séance : « Je suis contente d’avoir ma séance, je sens que les séances me font du bien. D’ailleurs je vous remercie parce que la dernière séance m’a vraiment fait beaucoup de bien. ».
Mais au lieu de recevoir tranquillement ces compliments, j’éprouve, à mon propre étonnement, de l’agacement. Que m’arrive-t-il ?
En vérité, je m’impatiente, parce que j’ai l’impression d’assister à une distribution de bons points menaçant de sacrifier la séance à cette ode à la psychanalyse, pour évoluer vers un discours de développement personnel : « J’essaie de me faire du bien, en ce moment. D’ailleurs, j’essaie de m’accorder des moments rien qu’à moi, rien que pour moi. L’autre jour, je suis allée marcher, toute seule, et j’ai senti que cela me faisait vraiment du bien… ».
Allegra ne fait pourtant là qu’exprimer tout le soin qu’elle tente de s’accorder. Son insistance dit assez, en creux, combien cela lui est difficile. Ce dont il est véritablement question, c’est justement de sa difficulté à prendre soin d’elle-même, mais elle se garde bien d’aller sur cette pente.
Elle « résiste », voilà tout. C’est son droit. Et c’est d’ordinaire mon rôle de redoubler de patience pour ne pas risquer le moindre forçage. Alors pour quelle raison, suis-je si agacée ?
« Elle est en train de parler pour éviter de dire ce qu’elle a à dire, et cela dure depuis trop longtemps ! », me souffle-t-on dans l’oreillette.
Ce n’est donc pas Allegra que je ne supporte plus, mais ses résistances. Je me demande quoi faire de cette émotion qui m’est de plus en plus difficile à contenir. Est-ce une impatience qui ne regarde que moi ? Ou est-ce le signe qu’elle est prête à passer outre ses résistances ?
Du passage à l’acte…
Si j’écrase cet affect tout au fond de moi, c’est-à-dire que je le refoule, je sais pertinemment ce qui risque de se produire : mon inconscient se vengera tôt ou tard, en me faisant commettre un passage à l’acte, autrement dit un acte impulsif qui va me faire dire ou faire quelque chose que je suis assurée de regretter. D’ailleurs, je me visualise déjà en train de secouer ma pauvre analysante !
Je réponds donc à mon inconscient quelque chose comme : « Ok, tu es en pétard, j’ai compris. Promis, dès que possible, j’aide cette personne à sortir de son baratin. Cette fois, pas question de laisser filer la moindre occasion. ». Je m’apaise un peu.
Mais Allegra reprend de plus belle : « C’est vraiment important pour moi, quand je fais quelque chose rien que pour moi, par exemple l’autre jour j’ai pris le temps de me mettre une crème pour le corps, c’est une chose que je ne fais pas d’ordinaire. ».
Mon inconscient revient à la charge, furibard. Je ressens alors quelque chose que je pourrais traduire par ces mots : « Vraiment ? On en est là ? On va se taper les crèmes pour le corps toute la séance ? Et toi, ça ne te pose pas de problème ? Tu vas laisser faire ça ? Tu veux que je m’en occupe ? ». Sûrement pas ! Je me refais la promesse qu’à la seconde où cet autre inconscient tentera d’en placer une, je lui viendrai en aide. Je ne le laisserai pas tomber.
… à l’acte analytique
– Hier, j’ai pris un bain, j’ai même pris soin de mettre une lotion moussante, je ne le fais jamais d’habitude…
– Mmmh… émets-je alors en me cramponnant aux accoudoirs de mon fauteuil, un peu comme sur un starting block, l’écoute suraiguisée par l’impatience.
– J’ai vraiment eu l’impression de m’occuper de moi… de…
– … de ?
– … de réussir à…
– Oui ?
– … de réussir à… à m’aimer. Oui… J’essaie… J’essaie de m’aimer. »
Ah ! La voilà, la brèche par laquelle je visualise tout à coup une petite main d’enfant, émergeant sous la masse de crèmes et de bains moussants. Émue, je demande en murmurant, comme s’il s’agissait d’un secret :
– C’est donc si difficile ?
– Quoi ?
– De vous aimer ?
– Et bien, vous le savez, c’est à cause du message que m’ont renvoyé mes parents toute mon enfance, comme quoi je n’étais qu’une moins que rien. Ça vient de là.
Mon agacement me reprend. Mais cette fois, il m’aide à tenir, à ne pas lâcher la petite main d’enfant qu’il me semble avoir saisie. Sur un ton ferme et doux, j’insiste :
– Je ne vous demande pas d’où elle vient, cette petite voix en vous qui ne vous aime pas, mais ce qu’elle a à nous dire…
La voix d’Allegra se fêle un peu :
– Et bien… elle dit que je suis nulle… C’est pour cette raison que c’est horrible pour moi ce qui se passe au boulot en ce moment…
Je sens que je me raidis à nouveau. Mais désormais, nous œuvrons ensemble, mon inconscient et moi. À cet instant, je lui suis reconnaissante d’être aussi exigeant, et j’aime cette analysante qui se débat, malgré ses résistances. Je reprends, plus fermement :
– Non. Je ne vous demande pas comment cette petite voix est aujourd’hui relayée par vos collègues, mais ce qu’elle a à dire, là, maintenant… Et si vous la laissiez s’exprimer ?
Silence. Au bout d’un moment, la voilà qui éclate en sanglots. « Nous y sommes », me dis-je, le cœur battant. Alors, elle parvient à articuler :
– Je… Je comprends… Oui… Je comprends ce que vous voulez que je fasse… Je vais essayer… Mais j’ai peur… J’ai peur de ce qui va sortir… C’est dégoûtant.
Délivrance
À cet instant, nous sommes trois à désirer la même chose : mon inconscient, moi, et la petite fille qui essaie de sortir des décombres de mensonges effondrés sur eux-mêmes depuis trop longtemps. Et ce que je ressens n’a plus rien à voir avec la moindre colère ou frustration, mais un immense amour pour cette petite fille, assorti d’une forme de reconnaissance et d’admiration pour le courage qu’Allegra s’apprête à avoir. Alors, comme une caresse, je dis :
– Qu’est-ce qui fait peur ? Qu’est-ce qui est dégoûtant ?
Un torrent de larmes la submerge et, finalement, un mot surgit, un seul. Un mot qui l’étonne elle-même et que, cette fois, j’entends à peine, tant sa voix a quitté le ton vainqueur du début de séance pour gagner le registre du secret auquel je l’avais invitée en murmurant :
– Déchet.
– Pardon ?
– Déchet !
– Déchet ?
– Oui. C’est le mot qui me vient. Je suis un déchet.
C’est le mot clef qui va permettre à la séance de déboucher sur l’horreur, la vérité contre laquelle elle lutte depuis toujours, ce secret tant de fois approché en séance, à chaque fois balayé, mais qu’aujourd’hui, elle laisse enfin éclater : elle n’est pas la fille de son père.
Elle est la fille de son oncle, qui a violé sa petite sœur de 17 ans. Elle est le fruit d’un inceste. D’ailleurs, sa mère est elle-même aussi l’enfant de cet homme, ce frère violeur, lui-même incesté par leur mère…
La mère d’Allegra est donc aussi… sa sœur. Et son oncle, qui est son père, est donc aussi… son grand-père. Son arbre généalogique ressemble à une toile d’araignée qui ne cesse de reboucler sur cet homme. C’est un cauchemar. Et tous les bains moussants et les crèmes du monde n’y pourront rien.
L’éprouvé qui fait preuve
À la suite de cette séance, tout remonte. Tout lui revient. Les preuves, les indices, tout s’emboîte. De mille et une manières, par des non-dits, des phrases échappées, des gestes, sa mère de sœur lui en avait autrefois laissé toutes les clefs. La voilà qui rassemble un à un les éléments de son histoire, ne laissant plus aucune place au doute.
Allegra y faisait parfois allusion, çà et là, mais sans y croire, un peu comme on suivrait le fil de la plus sombre des rêveries. J’essayais de répondre, en écho, à cette part d’elle-même qui se hasardait à dire, sur un ton en apparence si léger. Mais à chaque fois, mes tentatives avaient été déboutées.
Il m’aura fallu attendre, réessayer, patienter encore, tendant l’oreille au-delà d’un discours bien verrouillé où la loyauté familiale perdurait, à travers lequel me parvenait, comme de très loin, les accents d’une voix d’enfant. Jusqu’à ce que je n’y tienne plus.
Comme on le voit, quand l’analyste est envahi par un affect ou un désir qui lui paraît contraire à l’intérêt de l’analyse en cours, s’il trouve le moyen de ne pas céder à son impulsion première tout en mettant l’énergie qu’offre cet affect ou ce désir au service de l’analysant, cela permet généralement que se produise un bond décisif dans le processus analytique.
Et justement, mon impatience, ce jour-là, fut sans doute le signe qu’Allegra était elle-même prête à croire l’incroyable, autrement dit : à se fier à son éprouvé. Sans doute que cet agacement si fort était tout autant le sien, voire d’abord le sien, avant que d’être le mien…
Cet exemple illustre parfaitement la raison pour laquelle je préfère parfois parler de bande transférentielle plutôt que d’en rester à la traditionnelle conception binaire de transfert et de contre-transfert.
L’histoire
En assemblant les pièces du puzzle, l’histoire familiale put enfin prendre forme : tout avait commencé un soir de beuverie entre une mère et son fils de vingt-huit ans dont elle était tombée enceinte.
Douze ans plus tard, la petite jeune fille issue de cet inceste se fait violer par son frère de père et tombe enceinte à son tour. Ce premier enfant est une fille et sera reconnue par cet homme qui est par ailleurs marié, enfant qu’il « élèvera » dans la croyance d’être issue de son union maritale.
Cela ne l’empêchera pas, cinq ans plus tard, de mettre de nouveau sa pauvre sœur et fille enceinte. Mais cette fois, celle-ci est bientôt majeure et s’empresse de se marier dès ses dix-huit ans : elle entend bien garder ce second enfant, qui n’est autre qu’Allegra, et qu’elle élèvera dans la croyance d’être la fille de l’homme qu’elle vient d’épouser.
D’une lignée dont l’inceste fut le système, Allegra sera la seule à s’extirper définitivement, coupant les ponts avec les membres de sa famille, partant au loin fonder un foyer heureux avec un homme qu’elle aime.
Pourtant, inconsciemment rongée par le secret, elle en viendrait un jour à frapper à ma porte, persuadée de n’avoir qu’un problème de harcèlement professionnel à résoudre.
Interprétation
Dès le début, je m’étais étonnée de recevoir de sa part un transfert peu commun : si j’étais à la fois mise en place de la bonne mère, celle qu’elle aurait aimé avoir, et bien sûr aussi, celle de la mauvaise mère qu’elle craignait que je devienne à mon tour, cette projection maternelle ne faisait toutefois que s’entrapercevoir, comme un tabou sous le rempart d’un transfert plus officiel : j’étais d’abord mise en place de sœur, un peu comme pour dissimuler le transfert maternel sous-jacent, et cet agencement bizarre m’avait interrogée.
Je l’interprète aujourd’hui comme l’image inversée de la figure d’une Mère-(sœur) monstrueuse : j’avais été mise en place d’une sorte de Sœur-(mère) providentielle.
Bien sûr, elle s’était identifiée à cette image positive : comme souvent dans ces cas-là, elle parlait de son envie de devenir, elle aussi, psychanalyste, et elle avait évidemment envie que nous devenions consœurs, voire sœurs tout court.
À cette demande éperdue d’amour, j’avais répondu en analyste, c’est-à-dire « à côté », l’invitant à recevoir de moi la forme sous laquelle l’amour de l’analyste se donne : celle d’un geste pouvant l’aider un jour à se « remettre au monde ».
Une question d’amour
C’est cette manière frustrante qu’a l’analyste de décliner la demande éperdue d’amour de toute personne analysante qui sauvegarde, justement, la possibilité de lui en donner beaucoup plus et beaucoup mieux, par l’ouverture de l’issue libératrice tant désirée, mais à laquelle celle-ci n’ose jamais complètement croire.
En quelque sorte, on peut dire que, souvent, l’analyste aime son analysant malgré celui-ci. De plus, je n’étais pas la détentrice de la vérité qui la concernait, et ma seule façon de poser ce geste, celui dont elle avait véritablement besoin, n’était pas de devenir une sorte de « sœur » comme elle l’imaginait, mais de créer les conditions pour qu’elle puisse un jour se saisir elle-même du savoir historique dont elle était porteuse.
C’est tout le sens de la phrase de Lacan, pour parler de cet amour particulier de l’analyste envers son analysant, quand il affirme : « aimer, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » !
… mais qui, au fond, le désire plus que tout, sans le savoir, ni trop oser y croire.
D’un inconscient à l’autre
Ce jour-là, cette enfant avait parlé avec les mots que seule la vérité nous fait trouver, et les larmes que seule la pire de nos souffrances nous fait verser. En tâchant de l’entendre à travers les mailles serrées d’un discours bien ficelé, cette image de petit bras sorti des décombres s’était imposée à moi. Mais bien sûr, je l’avais gardée pour moi.
Peu de temps après, Allegra apporta un rêve en séance : elle marchait devant une mer de boue qui ne cessait de se retirer. Au loin se formait une vague géante, pleine d’immondices. Le temps qu’elle comprenne le danger qui la guettait, voilà que le tsunami dégoûtant fonçait sur elle : une centaine de mètres de boue allait s’abattre ! Elle était déjà en train de s’y faire engloutir quand, dit-elle, elle avait senti quelqu’un lui saisir le bras et la tenir fermement, lui permettant de s’extraire de toute cette immondice. Ce quelqu’un, ajouta-t-elle, n’avait pas de visage : c’était une femme qu’elle pensait être une sorte de sœur…
Décidément, la notion de « bande transférentielle » me semble ici trouver sa justification, en permettant de rendre compte de ce type de phénomènes auxquels les psychanalystes ont régulièrement affaire : tout comme l’émotion d’agacement, à qui appartenait cette image ? Cet affect comme cette image naviguaient quelque part, allant et venant visiblement d’un inconscient à l’autre.
Centralité de la question de l’inceste en psychanalyse
Ce geste d’amour, plein de l’énergie d’un agacement initial, lui avait permis de prendre au sérieux ce qu’elle savait déjà, sans en avoir jusque-là trouvé le courage. En en parlant à un autre être humain, et qui plus est analyste, la voilà qui pouvait intégrer l’humanité dont elle s’était toujours sentie exclue.
Les personnes victimes d’inceste se sentent souvent « hors humanité ». Captives d’une boucle secrète, ressentie comme honteuse, elles ont été comme retenues hors du monde.
Or, ce qui fonde notre humanité réside justement dans l’interdit de l’inceste : celui-ci nous permet de prendre place dans les générations, et donc, de prendre place dans le monde humain, de s’y sentir appartenir en toute légitimité.
D’une manière ou d’une autre, à des degrés divers, c’est souvent plus ou moins ce dont il est question, en psychanalyse : délivrer quelqu’un de ce qui le retient hors monde, du fait que la Limite (l’interdit de l’inceste, le respect des frontières élémentaires, psychiques, émotionnelles ou corporelles) ait été plus ou moins bien posée, soit qu’elle ne l’ait pas été clairement, de manière ambivalente ou brutale, soit qu’elle ne l’ait pas été du tout.
Voilà la raison pour laquelle la question de l’inceste, et son versant œdipien, est si centrale en psychanalyse.
Je conçois l’acte analytique comme un geste d’amour qui permet à l’analysant de se remettre au monde : il s’agit, côté analysant, d’une renaissance ; côté analyste, d’une maïeutique. Et ce geste vaut infiniment plus que tous les fantasmes ordinaires par lesquels l’amour, si éperdument attendu et parfois, ouvertement demandé à l’analyste, pourrait croire se donner ou se recevoir enfin.
Épilogue, par Allegra elle-même
Je ne sais pas si cela est courant, mais j’avais totalement oublié le déroulé de cette conversation si cruciale… libératrice, oserais-je même dire… Paradoxalement, la seule chose qu’il me reste de mes séances est quelque chose en moins, un cœur plus léger et délesté d’une histoire qui n’est finalement pas la mienne puisque j’ai rompu le sortilège… Je suis passée de l’autre côté.
Lire cet article m’a « brassée » car j’ai réalisé que je n’avais plus pensé au passé de ma mère depuis des années… Pas une fois… J’ai tracé mon chemin sans me sentir dépositaire ou responsable en quoi que ce soit de cette histoire.
J’ai trouvé ma voie professionnelle même si ce n’est pas encore totalement consolidé : j’ai conscience que je suis sur ma « propre » voie et je poursuis le chemin, même si tout n’est pas facile.
J’ai aussi appris à décrypter mon fonctionnement, débarrassée de tout ce qui m’encombrait et que la génération précédente avait insidieusement et silencieusement déposé en moi pour ne pas avoir à le régler.
Enfin, j’ai pu parler avec mon mari et mes enfants, et rompre le sort. Auprès d’eux, j’ai trouvé un soutien indéfectible.
Pourtant, par trois fois avant cette analyse, j’avais essayé d’aborder l’éloignement et la rupture avec ma famille, et plus spécifiquement ma mère et sa famille toxique, mais chaque thérapeute (psychologue ou psychiatre) avait été incapable de soutenir mon récit jusqu’à l’inceste fondateur… Préférant proposer une réconciliation avec ma mère, un jour peut-être…
En définitive, il me semblait qu’ils étaient personnellement en incapacité de soutenir mon discours du fait qu’il touchait à un tabou sociétal, caché dans une poupée russe : l’interdit judéo-chrétien de rompre avec ses parents (« Tu honoreras ton père et ta mère »), l’aura qui entoure chaque mère, l’impensable de l’inceste du côté maternel.
Ils représentaient à eux trois (femmes et homme de métier) un panel de la société, et m’adressaient une fin de non recevoir. Si mes thérapeutes n’avaient pas moyen d’en parler avec leur propre thérapeute, un superviseur ou un simple collègue pour interroger ce qui se jouait là pour eux inconsciemment, alors qui étais-je pour le faire ?
J’avais le sentiment qu’il était plus aisé de parler avec eux de rupture avec mon père que de rupture avec ma mère. J’étais en « errance thérapeutique »… J’enchaînais les échecs professionnels et je restais seule avec cette horrible histoire au fond de moi. J’essayais de faire le deuil de pouvoir en parler mais je gardais un infime espoir d’être entendue, un jour…
Je me suis dirigée vers la psychanalyse en ayant seulement lu à son sujet. Depuis plusieurs séances, j’évitais soigneusement le sujet. Cette psy saurait-elle le supporter ? Ou aurait-elle, elle aussi, une réaction qui aggraverait ma solitude et mon désarroi ? J’avais l’impression d’être réellement écoutée. Je me sentais bien, et je ne voulais pas tout gâcher avec mon histoire crasseuse…
La digue a cédé au moment où je me sentais prête à aller sous la surface. Je suis passée par toutes les étapes décrites dans l’article (transfert compris) pour mieux prendre mon envol.
Je n’avais pas réalisé à quel point cette analyse avait été libératrice jusqu’à la semaine dernière. Lorsque j’ai lu ce texte, je me suis dit : mais au fait, je n’ai plus de caillou au fond du bide, plus pensé à tout ça… Depuis deux ans et demi ? Déjà ? Pas un jour !!? Je n’oublie pas, mais je ne porte plus ce fardeau, qui n’est pas le mien.
Depuis, tout n’est pas parfait et je fais face aux épreuves de la vie comme tout un chacun. Mais ce qui est sûr, c’est que je me sens en paix avec le passé de ma mère. Ce qui me définit n’est pas tant cette histoire que la somme des belles choses que j’ai accomplies dans ma vie, les gens que j’aime et qui me le rendent au centuple.
Je suis tranquille avec tout ça. Je n’ai toujours pas envie de revoir ma famille de naissance mais je ne ressens plus d’émotions incommodantes (la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la haine de moi…dès que l’on parle famille).
Je n’aurais probablement jamais en main des documents attestant mon éprouvé mais à quoi cela me servirait-il ? Je vais bien. C’était l’objectif. Cette histoire n’est plus sur le devant de la scène avec mes proches, je peux vivre avec satisfaction ma vie de famille !
Me concernant, et malgré mes aprioris de départ, la psychanalyse était la meilleure réponse à mon mal-être profond !