Paroles
Ici la parole est aux analysants ! Des personnes racontent leur expérience singulière de l’analyse, celle qui leur permit d’entrer dans la narration d’elles-mêmes. Il s’agit de témoignages, célèbres et moins célèbres, écrits ou oraux.
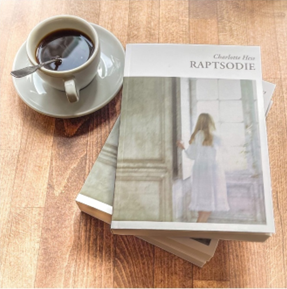
Tout commence dans un bureau de notaire. Le testament du père de ses enfants bouleverse l’équilibre précaire que la narratrice s’efforçait de préserver. Ce document réveille des blessures enfouies et ravive la mémoire des violences symboliques et tangibles qui ont jalonné son existence. Face à cette dépossession ultime, la colère cède la place à une quête introspective, un chemin à rebours pour comprendre comment, peu à peu, elle a été privée de son identité.
Entre souvenirs morcelés et prises de conscience fulgurantes, Raptsodie explore l’amnésie traumatique, les non-dits familiaux et la transmission insidieuse de la violence, de génération en génération. À la manière d’une enquête intime, le récit avance par fragments, au plus près du ressenti, jusqu’à remonter aux origines de la douleur.
Fusion des mots «rapt» et «rhapsodie», le titre illustre un parcours contrasté : celui d’une femme en quête de sens et de réparation, refusant que les traumatismes hérités dictent l’avenir. Raptsodie est un cri de révolte autant qu’un acte de liberté, un témoignage aussi intime qu’universel sur la lutte pour se réapproprier sa propre histoire.
https://sens-dessous-dessus.ghost.io/raptsodie
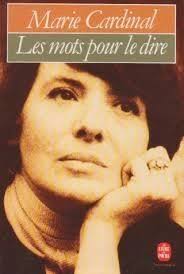
Pas de mots pour dire l’émotion que provoque la lecture de ce livre : on a envie de hurler avec la narratrice, page après page. Asphyxie. Livre-cri, livre-coup, d’une sincérité violente, sans concession, ce récit ne ressemble à aucun autre. Jamais on n’avait osé employer comme elle le fait « les mots pour le dire » : les mots vrais, les mots interdits, les mots qui délivrent.
Désemparée, au bord de la folie, elle décide un jour de confier son destin à la psychanalyse.
Au fil des séances, elle remonte le chemin de sa vie, dont les étapes s’éclairent les unes après les autres : le divorce des parents, la mort du père, les traumatismes sexuels de l’enfance, l’adolescence dans une Algérie en guerre et, par-dessus tout, l’ultime souvenir arraché aux ténèbres du refoulement, cet aveu d’une mère, qui est peut-être à l’origine de tout le mal. Avec un acharnement qui vient à bout de toutes ses résistances intérieures, la narratrice fait peu à peu la lumière sur son passé. Au terme de son récit, enfin délivrée de ses angoisses, elle pourra recommencer à vivre.
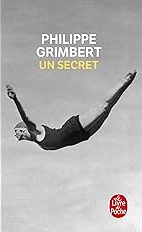
Souvent les enfants s’inventent une famille, une autre origine, d’autres parents.
Le narrateur de ce livre, lui, s’est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu’il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas… Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante. Et c’est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu’il lui incombe de reconstituer.
Une histoire tragique qui le ramène aux temps de l’Holocauste, et des millions de disparus sur qui s’est abattue une chape de silence.

« Tu me connais, mon chéri, je ne t’écrirai pas. » Et toujours elle m’écrivait. En écrivant ce récit, j’ai compris toute la portée de cette promesse allègrement trahie. Ces lettres, ces petites cartes, tel un aveu, m’apportaient la seule bonne nouvelle : ma mère m’aimait, malgré elle, mais elle m’aimait. (…) C’est pour cela que je me suis accroché aux mots. Ils furent toujours mes alliés, que ce soit seul devant ma feuille de papier, devant l’écran de mon ordinateur, dans le secret du cabinet de l’analyste, je n’ai eu que les mots pour déjouer les mensonges et traquer la vérité où qu’elle se niche, que les mots pour faire parler les silences et pour accoucher les morts de leur vérité, fut-elle terrible. »
Seule la littérature peut rendre compte de l’ineffable de la psychanalyse. « Jean-Marc Savoye y parvient en évitant les écueils de l’impudeur ou de l’apitoiement dans un récit qui lui appartient en propre mais nous concerne cependant tous, névrosés ordinaires que nous sommes » écrit Grimbert.
C’est aussi un projet totalement inédit : par des interventions ponctuelles lumineuses, Philippe Grimbert, avec qui Savoye a terminé son analyse, éclaire pour son ancien analysant et pour le lecteur, ce qui s’est joué. Un pari admirablement réussi.
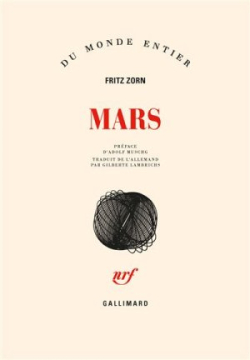
Sous le pseudonyme de Fritz Zorn (et Zorn en allemand signifie « colère »), se cache un jeune homme pressé : condamné par un cancer qui ne lui laissera aucune chance, l’écriture de ce livre est une course contre la montre. Il le dit : il n’a jamais vécu. Zorn a toujours été un « hors la vie ». Propre, sage et faisant honneur à sa famille, fleuron de la grande bourgeoisie zurichoise, il n’a jamais fait de vagues, s’est conformé, a emprunté docilement la voie qu’on lui avait tracé et qui l’incitait à se méfier du monde extérieur et de ses vices. « J’ai été éduqué à mort », assène-t-il. Pour cet homme, le cancer n’est que l’issue naturelle d’un étouffement systématique. Ce constat clinique, glacial mais non dénué d’humour, Zorn le livre dans sa version brute. Mars est le dieu qui le guide désormais : c’est un cri de guerre, celle envers et contre toute la fatalité qui s’abat sur lui, une guerre perdue d’avance, mais qu’il entend mener, par principe, pour donner sens au temps qui lui reste et dénoncer un système qui sacrifie ses enfants.
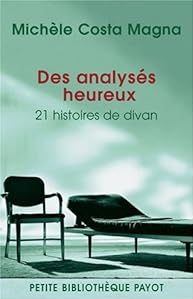
A quoi sert la psychanalyse ? Pour s’y risquer, faut-il être malade mental, » avoir un grain « , ou simplement ne pas aller bien ? Pourquoi s’allonger sur un divan ? Quel psychanalyste choisir ? Que lui dire ? Pour répondre à ces questions, voici les témoignages de 21 personnes qui, ayant fait une analyse (terminée au moment où elles parlent), en sont satisfaites et ont accepté de la raconter. Treize femmes et huit hommes qui évoquent leur histoire telle qu’ils l’ont partagée avec leur psychanalyste.
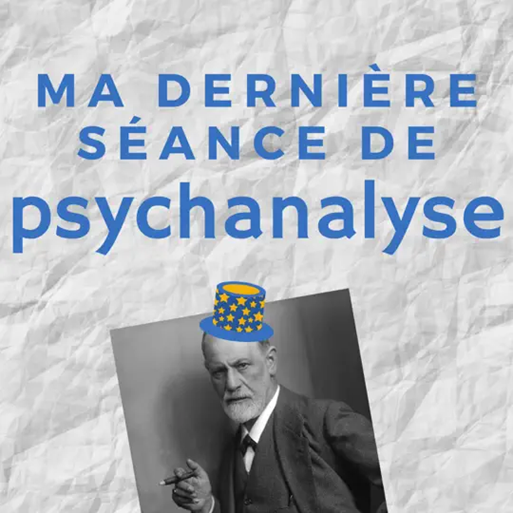
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/ma-derni%C3%A8re-s%C3%A9ance-de-psychanalyse/id1566136873
C’est le podcast de Guillaume Bonnet, qui se demande si la psychanalyse marche… Et quand ça marche, pourquoi ? En interviewant des gens qui en ont fait l’expérience, il axe ses questions sur leur dernière séance et l’impact que leur analyse a eu sur leur vie…
Et encore d’autres récits :
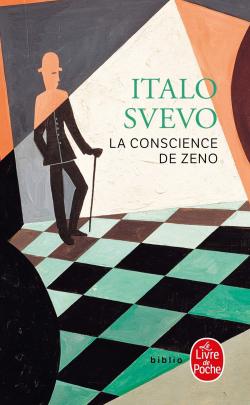
Composé en 1923, La Conscience de Zeno est sans doute le premier grand roman inspiré par la psychanalyse. Mais il est bien plus que cela. Avec la confession de son héros – narrateur qui entreprend d’évoquer pour le médecin qui le soigne les faits marquants de son existence, il demeure l’un des livres fondateurs de la littérature européenne du xxe siècle. C’est Eugenio Montale, Benjamin Crémieux et Valery Larbaud qui révélèrent et imposèrent simultanément, en France et en Italie, pendant l’hiver 1925-1926, le nom d’Italo Svevo, l’écrivain triestin né en 1861, et qui allait mourir en 1928…
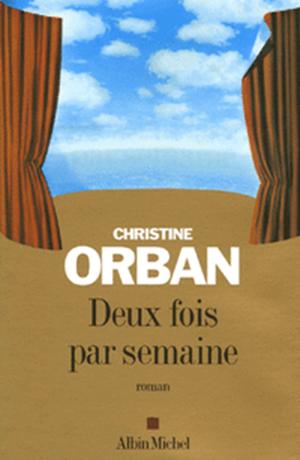
Pouvez-vous répondre à une seule question ? Si je vous parle et que vous parveniez à me guérir, ce sera pour vivre quoi ?
Un roman qui se lit comme une leçon de vie.
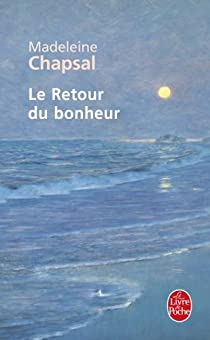
Avec la franchise sans détour qui a fait le succès de La Maison de jade, Madeleine Chapsal raconte ici son expérience de la psychanalyse. À l’époque, jeune divorcée confrontée à la solitude et à l’impossibilité d’avoir des enfants, elle n’a pas encore découvert sa vocation de romancière.
Elle est simplement une femme qui ne veut pas » se laisser avoir » par le destin, les hommes, le temps. Beaucoup reconnaîtront leurs problèmes dans ce témoignage.
Et ceux ou celles qui hésitent devant la psychanalyse trouveront ici, à côté de portrait de grands analystes comme Serge Leclaire et Françoise Dolto, une réponse aux questions qu’ils se posent : comment choisir son psychanalyste, quelles sont les règles qui régissent le traitement, etc. Retour du bonheur ? En tout cas, retour à la vie.
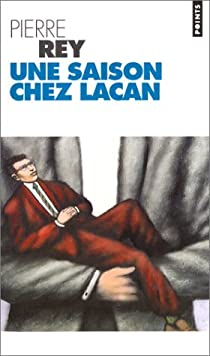
À trente ans à peine, Pierre Rey a toutes les apparences d’un jeune homme heureux, il fait partie de ceux qui ont « réussi ». Chroniqueur dans un quotidien, joueur invétéré vivant très au-dessus de ses moyens, il mène une vie mondaine et frivole dont le plaisir est l’unique objet. Pourtant, ses angoisses se multiplient, sa peur d’affronter le vide grandit.
Alors, il décide de faire table rase du présent, quitte travail et amis, et gravit les marches de pierre usées du 5 rue de Lille qui conduisent chez Lacan. Et c’est là, pendant dix ans, qu’il effectuera sur le divan du célèbre analyste le plus long de ses voyages.
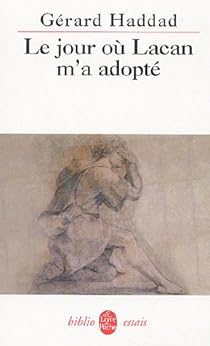
Ce texte est le récit, presque le roman, d’une expérience qui a transformé radicalement la vie de son auteur. En 1969, alors qu’il est ingénieur agronome, Gérard Haddad rencontre Jacques Lacan et commence avec lui une psychanalyse. Cette aventure va durer une dizaine d’années au cours desquelles se sera opérée une métamorphose. Ce livre raconte donc un parcours et les incroyables rebondissements qu’il suscite. C’est un témoignage exceptionnel et en direct sur la pratique de Lacan. Les séances quotidiennes, de quelques minutes seulement, où Gérard Haddad expose sa vie dans ses moindres détails, se transforment parfois en fulgurances qui bouleversent tout. On voit comment Lacan intervenait dans la cure, son engagement et le cycle de formation que suivaient ses élèves. Lacan, personnage si célèbre mais mal connu, à travers l’image brouillée qu’il aimait donner de lui-même, s’y révèle attentif, génial et généreux. Marxiste athée, l’auteur voit avec stupeur émerger, au cours de son analyse, la force du sentiment religieux qui l’habite. Ce retour a conduit Gérard Haddad à retrouver le judaïsme et à l’étudier en lecture croisée avec la psychanalyse. Ce judaïsme trouvera sa forme ultérieurement dans la rencontre du personnage prophétique de Yeshayahou Leibowitz. La fin de cette psychanalyse a coïncidé avec la fin de la vie de Lacan et les violentes querelles qui ont alors opposé ses élèves. Ce texte constitue un témoignage sur ces événements auxquels Gérard Haddad fut directement mêlé.
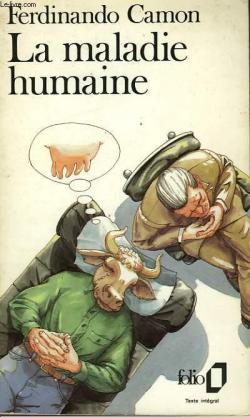
Le narrateur est mal en point. À force de courir de médecin en hôpital, il rencontre un psychanalyste. Jamais cure n’aura été décrite avec autant de précision et de drôlerie. Mais c’est la société elle-même qui est dépeinte aussi, dans sa crise où s’effacent notre mère l’Église et notre père le Parti. Plus profondément, c’est l’homme même qui est par essence inguérissable : » Plus l’homme devient homme et se différencie de l’animal, plus son mal s’aggrave. «
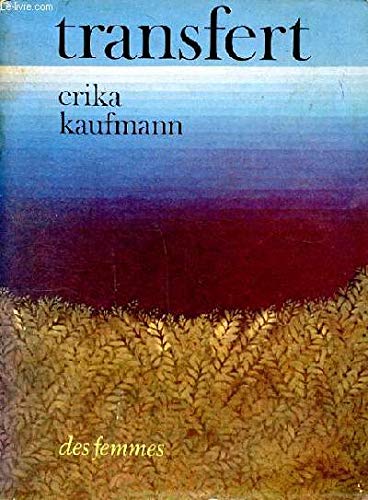
Une analyse reste secrète. Ça se dit, ça s’écoute, ça ne s’écrit pas. Le dire englouti dans le silence, parfois capitalisé dans le savoir de l’analyste. L’inconscient de nouveau chassé, il y a perte de révolte. De lutte. Mon inconscient réclamait une parole, une écriture. J’écrivais des lettres à mon analyste…